
Une technique de psychologie positive : le comptage des bénédictions
Dans un précédent article, vous avez pu découvrir les fondements de la psychologie positive mais aussi une technique efficace pour augmenter son bien-être, la lettre de gratitude, dont les effets ont été mesurés scientifiquement.
Aujourd’hui, je vais vous présenter une seconde technique issue du champ de la psychologie positive: le comptage des bénédictions.
Que signifie le comptage des bénédictions ?
Le comptage des bénédictions renvoie au fait de lister les actes pour lesquels vous pouvez être reconnaissant sur une période donnée. Cette technique s’inscrit, comme la lettre de gratitude, dans une démarche de reconnaissance. Une étude publiée par Emmons et McCullough en 2003 a montré les effets bénéfiques du comptage des bénédictions qui amène chaque individu à percevoir sa vie de façon plus positive, à devenir optimiste. Les individus qui ont pratiqué cette technique ont ressenti plus d’affect positif et ont été plus enclines à aider quelqu’un qui présentait un problème personnel en lui offrant son soutien moral.
Description du protocole de recherche
Cette recherche comportait 3 études différentes. Dans la première, 192 étudiants se sont portés volontaires, 157 dans la seconde et 65 adultes atteints d’une maladie neuromusculaire pour la dernière.
La première étude proposait aux participants de lister cinq faits pour lesquels ils pouvaient être reconnaissants au cours de la semaine précédente, cinq tracas et maximum cinq événements qui avaient eu un impact significatif.
Dans la seconde étude, les participants devaient réitérer la même procédure, mais en écrivant chaque jour jusqu’à cinq événements qui pouvaient générer un sentiment de reconnaissance mais aussi les tracas qu’ils avaient connus. Les participants devaient enfin exprimer par écrit ce qui faisait qu’ils étaient meilleurs que les autres.
Dans la dernière étude, les participants effectuaient un comptage des bénédictions ou rapportaient sur un carnet la manière dont ils s’étaient sentis au quotidien, et la façon dont ils s’étaient perçus globalement.
Au final, les individus qui ont compté les bénédictions dans les 3 études ont ressententi plus d’affect positif, ont été plus optimistes et plus enclins à aider autrui, à lui apporter un soutien émotionnel. La fréquence du comptage des bénédictions a également eut un impact sur le niveau de bonheur : effectué de manière quotidienne (étude 2 et 3), celui-ci a montré des effets plus puissants que celui effectué une seule fois par semaine (étude 1).
Pourquoi utiliser la gratitude ?
Le comptage des bénédictions repose sur le fait de montrer sa gratitude envers autrui. La gratitude résulte d’un processus cognitif en 2 étapes : reconnaître que l’on a obtenu un résultat positif et reconnaître que c’est une source extérieure qui a mené à ce résultat positif (Weiner, 1985). La reconnaissance peut ainsi être un levier important pour favoriser le bien-être, elle peut constituer une stratégie psychologique par laquelle les individus interprètent de façon positive leurs événements de vie et ainsi les conduire à se sentir plus heureux, davantage optimistes et ouverts aux autres.
Référence : McCullough, M. E., & Emmons, R. A. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389.


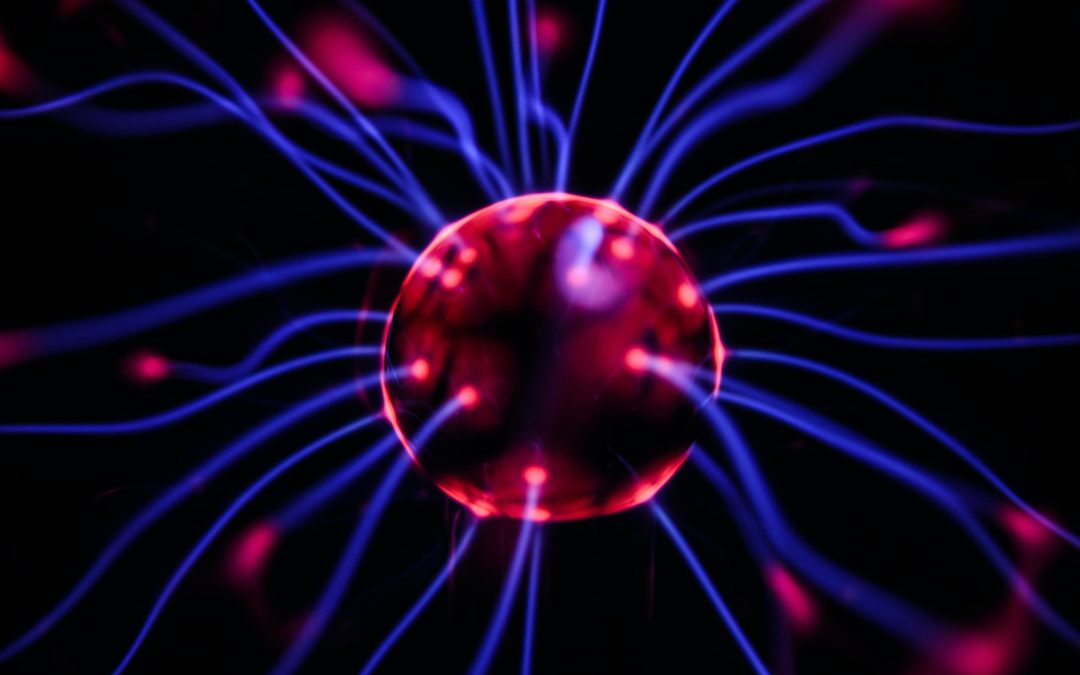


Commentaires récents